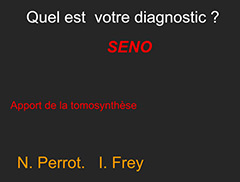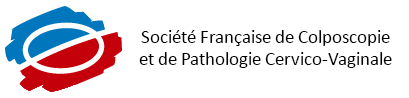Réflexions éthiques sur la stérilité utérine définitive
La stérilité utérine définitive n’a pas trouvé jusqu’ici, en France, une offre de soin comparable à ce qui peut être proposé dans les autres stérilités. En 2014, l’équipe de Mats Brännström en Suède a publié sa remarquable série de succès après greffes d’utérus à partir de donneuses vivantes2. Une avancée supplémentaire s’est produite en 2018 avec une naissance après greffe d’un utérus provenant d’un prélèvement sur une patiente décédée au Brésil.
L’équipe de Brännström avait obtenu en 2012 une autorisation de son université pour 9 greffes à partir de 9 donneuses vivantes3. Les donneuses étaient des parentes ou amies proches des receveuses et avaient 53 ans de moyenne d’âge. L’une d’entre elles était la mère de la receveuse. Huit receveuses de 31,5 ans en moyenne avaient un syndrome de MRKH et une receveuse avait eu une hystérectomie pour un cancer du col. Une mise en réserve d’embryons avait été réalisée pour chaque femme un an avant la chirurgie. Il a fallu retirer deux greffons l’un pour une infection, l’autre pour une thrombose, et une fistule urétéro-vaginale est survenue chez une donneuse malgré la très grande expertise en matière de greffe de cette équipe. L’évolution post greffe a donné des règles dans les 2 mois chez les 7 receveuses qui n’ont pas été explantées.
Les traitements immunosuppresseurs ont été commencés avant l’intervention chirurgicale par Tacrolimus et Azathioprine et ont été poursuivis pendant la grossesse ainsi que des Corticoïdes chez 4 patientes pour des épisodes infracliniques de rejets dépistés par une biopsie de col utérin. Le retrait des greffons utérins est prévu après 1 ou 2 naissances. Il s’agit d’une chirurgie expérimentale ou 2 greffes sur 9 ont échoué. Les gestes chirurgicaux ont été plus longs que prévus et les risques médicaux et psychologiques sont encore mal évalués.
Il y a donc désormais, depuis ce succès historique, quatre possibilités thérapeutiques pour remédier à la stérilité utérine définitive :
- L’abstention qui est toujours un choix possible en matière de stérilité. Il est vrai qu’on peut vivre sereinement sans enfant.
- L’adoption d’un enfant, une solution également non spécifique de la stérilité utérine.
- La gestation pour autrui, totalement interdite en France de manière constante.
- La greffe d’utérus, autorisée en France, autorisation paradoxale au plan éthique au regard de l’interdit de la GPA.
Parmi les deux solutions proprement thérapeutiques disponibles, l’une existe déjà depuis une trentaine d’années, la GPA, et l’autre est en cours de mise au point en France en particulier4 à la suite du travail de Brännström. Ces deux solutions, comme souvent en AMP sont palliatives et non curatives.
Les causes de l’infertilité utérine sont diverses :
- Le syndrome Muller, Rokitansky, Kuster, Hauser (MRKH)
- Les hystérectomies obstétricales ou carcinologiques
- Les Utérus incapables de grossesse (hypoplasie, Fausse couche à répétition, échec d’implantation)
- Et accessoirement les dysphories de genre et la convenance personnelle.
La greffe d’utérus ne constituera donc pas une solution pour les pathologies maternelles rendant une grossesse dangereuse ou impossible. L’exemple du syndrome de Turner avec ses anomalies aortiques spécifiques5a d’ailleurs été l’objet de recommandations officielles. Les pathologies maternelles qui font courir un risque vital à une femme en cas de grossesse ne sont pas concernées par la possibilité d’une greffe d’utérus.
La plus fréquente de ces indications est congénitale : c’est l’anomalie décrite par Muller, Rokitansky, Kuster et Hauser ou syndrome MRKH. L’absence congénitale de l’utérus et de la partie supérieure du vagin a donné lieu à de nombreuses techniques de restauration du vagin quand celui-ci ne permet pas les rapports sexuels. La stérilité définitive y est annoncée en même temps que le diagnostic qui est fait en général vers 17 ans à l’occasion de l’exploration d’une aménorrhée primaire. On a peu d’évaluations fiables sur la prévalence réelle de ce syndrome. Les chiffres couramment repris dans la littérature sont de l’ordre de 1 cas pour 4 500 naissances. Il s’agit d’une agénésie des structures issues des canaux de Müller, les 2/3 supérieurs du vagin, l’utérus et les trompes. Le phénotype est féminin et le caryotype est 46 XX. La fonction ovarienne est normale. Ce syndrome est sporadique et sans anomalie associée sauf rarement des anomalies rénales.
L’absence acquise de l’utérus est également fréquente :
L’hystérectomie d’hémostase concerne approximativement une femme sur mille en Europe. La pathologie carcinologique de l’utérus (col), les myomectomies avec délabrement utérin, les synéchies totales, les amputations du col de l’utérus, les adénomyoses sévères et l’hypoplasie utérine (DES et autres causes) constituent des indications moins fréquentes pour lesquelles on ne dispose pas de chiffres de prévalence.
Au total le nombre de femmes concernées a été évalué à 15 000 en Grande Bretagne6, à 3 000 en Suède, à plusieurs dizaines de milliers aux USA. Il est raisonnable de penser que les demandeuses françaises sont également autour de 15 000, si on tient compte de la nécessité d’une réserve ovarienne normale, de l’absence de contrindication à la grossesse, et de l’absence de contrindication à la greffe proprement dite.
Les effets présumés sur l’enfant7 sont peu importants voire inexistants. L’immunosuppression est légère. La greffe est non vitale et peut donc être éphémère. On dispose depuis 50 ans de données rassurantes : sur les 15 000 enfants nés de mères transplantées rénales, il n’y a pas plus de malformations que dans la population de référence. Il sera de plus probablement possible à l’avenir de s’affranchir de l’immunosuppression grâce à la bio ingénierie utérine.
La greffe utérine ne répond donc qu’à une partie des indications de la stérilité utérine définitive :
- Le syndrome MRKH
- Les hystérectomies quelles que soient leur cause
- Les Utérus incapables de porter une grossesse
- Les dysphories de genre
Mais la greffe utérine ne sera pas valable pour les pathologies maternelles rendant une grossesse dangereuse pour la mère.
La deuxième solution thérapeutique palliative est représentée par la GPA.
La Grossesse pour autrui a été rendu possible par les techniques d’AMP. Auparavant, la « maternité de substitution » désignait la pratique par laquelle une femme acceptait d’être inséminée avec le sperme de l’époux ou du compagnon, puis de porter et de mettre au monde l’enfant ainsi conçu, pour le remettre à la naissance au couple receveur. La femme qui faisait don de l’ovocyte et de ses capacités gestationnelles remplaçait totalement les capacités reproductives de la femme infertile, d’où l’expression de « maternité de substitution ». Dans ce type de GPA, la femme qui accouchait, abandonnait l’enfant dès la naissance. Celui-ci, déclaré sans indication de filiation maternelle, était accueilli dans son foyer par le père qui, de son côté, avait fait une reconnaissance anténatale. Quelques temps plus tard, l’épouse du père formait une demande en adoption plénière.
Le rapprochement des couples d’intention du projet parental et des femmes candidates à la maternité de substitution était assuré dans les années 80 par des associations dont les plus connues étaient « Les cigognes » en Alsace et « Alma Mater » à Marseille. A travers deux décisions relatives l’une à l’activité des associations créées afin de servir d’intermédiaires en matière de maternité pour autrui, l’autre à l’adoption des enfants nés grâce à l’intervention d’une mère de substitution, la Cour de cassation mit fin à ces pratiques.
La GPA dite « gestationnelle » est rendue possible par les techniques d’AMP. Une femme assure la gestation d’un embryon qui lui est étranger du point de vue génétique. Ainsi, on distingue deux catégories de GPA. La première correspond au cas où la mère d’intention a une fonction ovocytaire normale, mais ne se trouve pas en mesure d’assurer la phase de gestation en raison d’une pathologie utérine. L’embryon est conçu avec les gamètes du couple d’intention. Dans la seconde, lorsque la mère d’intention présente également une altération de sa fonction ovarienne, l’embryon transféré dans l’utérus de la gestatrice est conçu avec l’ovocyte d’une autre femme donneuse et un spermatozoïde du père. Dans la GPA « gestationnelle », la gestatrice n’est jamais la mère génétique de l’enfant.
Le 31 mai 1991, l’Assemblée plénière a condamné le recours à la maternité pour autrui en censurant un arrêt qui avait prononcé l’adoption, par l’épouse du père, d’un enfant né d’une mère de substitution. La Haute Cour a fondé sa décision sur l’illicéité de la convention de gestation pour autrui. Elle estimait que ce procédé représentait une entrave aux principes d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes, et que l’activité de l’association constituait une incitation à l’abandon d’enfant ainsi qu’un détournement de l’adoption.
La GPA est un sujet sensible car elle mobilise la filiation, la famille, l’engendrement et les grands principes moraux de l’occident. Il n’est besoin, pour s’en rendre compte, que de laisser courir à ce sujet l’interrogation autour de la table familiale pour sentir immédiatement que la diversité des avis ne parcourt pas les clivages habituels, politiques ou philosophiques des uns et des autres. L’histoire personnelle de chacun nous rappelle aisément que la fonction maternelle est plus délicate, plus complexe, que la fonction paternelle. Cette dernière a d’ailleurs été si profondément malmenée depuis quelques décennies, que l’on comprend le réflexe intuitif de nombreuses personnes de vouloir protéger la maternité des coups de boutoir de la modernité. « La seule chose qui soit sûre et certaine dans ce monde où tout bouge si vite, c’est la maternité ». L’éthique est bousculée par la technique. Ce qui se réalisait parfois dans le secret des familles, à savoir la session secrète d’un enfant, ne peut trouver aucune place dans notre système anthropologique moderne.
Mais la possibilité d’utiliser les gamètes des parents d’intention ou des gamètes d’une autre femme que ceux de la mère porteuse, permet d’entrer dans une configuration imaginable pour soigner l’absence (ou l’anomalie) de l’utérus devenue ainsi une catégorie de stérilité curable par un moyen palliatif : l’utérus d’une autre femme, que celui-ci soit transplanté ou non. Il nous faut donc interroger la complexité de ce sujet au regard des valeurs morales de notre société laïque et républicaine.
La législation actuelle sur la GPA donne un certain confort : elle interdit tout. Et elle autorise la greffe d’utérus sans grande discussion éthique préalable d’ailleurs. L’avantage majeur de cette dernière est que c’est bien la mère qui accouche. Elle ne remet pas en question un des grands principes du droit français : celle qui accouche est la mère de l’enfant. Cette position qui a le mérite de la clarté, ne dispense pas de dire ce que le droit français protège par cet interdit de la GPA (interdit renforcé par des peines de prison et d’amendes sévères pour les contrevenants), ne dispense pas d’expliciter la philosophie de ce droit et oblige à dire comment la France entend gérer les problèmes de filiation induits par cette pratique lorsqu’elle est mise en œuvre l’étranger. Une question importante est de savoir si cette prohibition complète n’a pas plus d’effets pervers que d’avantages, y compris sur le plan éthique. Il est en effet difficilement admissible de ne pas se préoccuper de ce qui se passe dans d’autres pays en conséquence des interdits que nous édictons en France.
Au centre du débat éthique sur les GPA se trouve la relation de subordination d’une femme vis-à-vis d’une autre et son instrumentalisation possible. Sûrement la question la plus délicate à traiter : l’indisponibilité du corps humain et la répulsion que nous éprouvons tous de le faire entrer dans le champ des biens et des contrats. Au centre du débat éthique également, le sort de l’enfant ainsi conçu et les conséquences négatives qui peuvent l’atteindre, voire altérer ses droits, lui qui n’est responsable en rien de ces montages compliqués. L’instabilité juridique issue de ces pratiques à l’étranger peut confiner au drame lorsque l’enfant n’a toujours pas d’état civil validé après plusieurs années de vie et que sa filiation maternelle non établie lui fait courir de nombreux risques juridiques, en cas de disparition de son père notamment. Ces enfants ne vivent donc pas l’égalité des droits à laquelle ils peuvent fort justement prétendre.
Pour rendre le débat plus complexe encore, la nature des demandes de GPA est très variable. On ne peut pas comparer, la demande d’un couple sans enfant où l’hystérectomie d’hémostase et la mort de l’enfant lors d’une complication obstétricale grave se sont joués en un seul acte dramatique, avec par exemple, la demande de GPA de confort pour évoquer une extrémité certes rare mais qui pourrait exister si on libéralisait totalement la pratique de la GPA. Le « tout est permis » ne serait pas mieux que l’actuel « tout est interdit ». Le législateur se trouve donc confronté à une grande hétérogénéité des demandes :
- Certaines situations où l’on pourrait être tenté de dire qu’il y a une réelle légitimité à aider un couple en France où règne la clarté dans les procédures et dans les comportements éthiques et où l’on peut organiser l’égalité des droits malgré les différences de revenus.
- Certaines situations en revanche, où de nombreux arguments moraux viennent s’opposer à ce type de démarche et où la loi peut fonder son interdit sur des valeurs communes à une majorité de Français.
Les demandes de GPA, si l’on sortait de l’interdit complet et total dans lequel nous nous trouvons actuellement, pourraient être analysées au cas par cas. Un Comité Pluridisciplinaire Régional de la Parentalité (CPRP), paritaire entre professionnels et non professionnels, entre femmes et hommes et des personnalités compétentes au plan du droit de la famille pourraient prendre le temps d’instruire ces demandes afin de dire si la GPA sollicitée respecte bien les droits de l’enfant et les droits de la mère porteuse quant à l’indisponibilité de son corps. Les médecins pourraient y être auditionnés en tant qu’experts techniques. Il pourrait même apparaître prudent que l’autorisation finale ne soit pas donnée en région, mais par une institution nationale, après avis de la commission régionale. Le nombre des demandes est vraisemblablement compatible avec une centralisation nationale qui aurait le mérite de diminuer la variabilité des décisions due à la diversité des subjectivités.
Les motivations des femmes pour être « mères porteuses » sont pour moitié essentiellement financières. L’autre moitié est constituée de femmes qui disent en substance ceci : « J’ai la chance d’être entière et de pouvoir donner le jour à des enfants ; le propre des humains, c’est de savoir s’entraider. Je suis d’ailleurs donneuse de sang et de moelle. J’aime être enceinte et j’aime donner le jour à un enfant et ma famille est d’ores et déjà constituée. Ce serait une très grande chance pour moi de pouvoir me sentir utile à ce point en rendant un service aussi important à une autre femme dépourvue de son utérus ». Cette générosité-là, entre femmes, existe. C’est d’ailleurs cette même générosité qui prévaut, en plus intense encore compte tenu de la lourdeur du geste opératoire, dans les dons d’utérus. Et l’entretien avec une telle femme, prolongé au besoin par la rencontre avec des psychologues, permet, avec une grande probabilité de dire vrai, d’identifier les motivations des mères porteuses et de s’assurer de leur intégrité décisionnelle et de leur indépendance y compris pécuniaire. Les associations de femmes cherchant à rendre ce service peuvent d’ailleurs constituer un filtre efficace. L’analyse des revenus de la femme qui se propose pour être mère porteuse pourrait faire partie des éléments pris en compte, pour éviter que des femmes ne soient tentées du fait d’un besoin d’argent. Et d’ailleurs, la possibilité de ne porter qu’une seule fois un enfant pour autrui pourrait éviter que la motivation ne soit financière. Ce modèle existe depuis 30 ans à Londres et le recul qui y est disponible est plutôt rassurant.
Quant à l’implication des femmes de la famille, les problèmes de « dette impayable » qui peuvent faire des ravages au plan psychologique conduisent à penser qu’il n’est pas souhaitable que ce soit la mère de la femme qui porte l’enfant pour sa fille. Une sœur, pourquoi pas, mais à la condition d’être assuré par des entretiens itératifs que des pressions intrafamiliales ne se sont pas exercées sur la sœur pour qu’elle accepte. Et au moindre doute, refuser.
Sur l’indis p onib ilité du corp s h umain
On rémunère mieux un soldat français déployé sur un territoire en guerre, car le risque de décès y est plus élevé que s’il restait en France. Il se fait donc payer le risque supplémentaire d’y perdre la vie. De même qu’un mineur dans une mine de charbon exposé à la silicose et aux coups de grisou, de même qu’un sous marinier qui se consacre pendant de longs mois à sa tâche et court des risques qui lui sont dûment rémunérés conformément à un vrai contrat de travail. Mais que dire aussi du don d’organes entre vivants, où le décès d’un donneur de lobe hépatique s’est produit il y a quelques années. A l’occasion de cette comparaison, se trouve fréquemment avancé l’argument selon lequel le don d’organe est justifié en ce qu’il sauve une vie, ce qui n’est pas le cas d’un don de gestation. Mais le recours au don de gestation ne se fait pas à la légère, il est souvent l’aboutissement d’un long parcours médical et psychologique, jalonné d’espoirs et de déceptions. La femme qui fait don de ses capacités gestationnelles ne sauve pas une vie au sens biologique du terme, mais elle sauve une existence, c’est-à-dire le sens d’une vie : en participant à donner la vie, elle participe à l’accomplissement, pour ceux qu’elle aide, du sens de leur vie. Et les femmes qui ont pratiqué la GPA l’ont bien compris lorsqu’elles font part du sentiment de gratification narcissique qu’elles ont retiré de leur don. La décision d’une femme de prendre le relais d’une autre dans un processus aussi fondamental que celui de la procréation, dès lors qu’elle agit de façon parfaitement libre et éclairée, a le sens d’un acte de générosité et de liberté que la loi, peut-être, se doit de reconnaître et de protéger.
La greffe d’utérus à partir d’un donneur vivant, acceptée sur son principe assez facilement en France, attente pourtant sérieusement à l’indisponibilité du corps humain.
Un temps opératoire pour la donneuse de plusieurs heures, la possibilité de complications chirurgicales, la perte d’un organe avec la modification du schéma corporel que cela entraîne sont autant d’éléments qui montrent que, si on n’utilise pas une donneuse décédée, on attente aussi sévèrement au principe d’indisponibilité du corps humain par cette technique que par une GPA. En tous les cas la différence éthique pourrait sembler bien mince, la complexité et le risque en moins pour la GPA8.
De nombreuses circonstances attentent donc à l’indisponibilité du corps humain et de fait, le consentement d’un adulte correctement informé et non vulnérable pourrait constituer un guide raisonnable. Mais en tout état de cause, interdire la GPA (alors qu’on autorise la greffe d’utérus) pour protéger les françaises contre elles même, car elles ne seraient pas à même de savoir ce qui est bon pour elles, constitue une posture autoritaire et paternaliste difficile à justifier.
Et les dérives marchandes que l’on observe dans ce vaste marché qu’est le monde, loin de constituer un contre argument à la pratique des GPA en France, viennent souligner un devoir de notre pays de se doter d’une loi exemplaire qui soit autre chose que le simple refoulement hors de nos frontières de nos problèmes difficiles. L’odieux trafic d’organes qui prévaut ici ou là n’a pas non plus fait interdire la greffe d’organe en France. Le trafic d’enfants, volés chez les pauvres pour être revendus chez les riches, n’a pas non plus fait cesser l’adoption internationale en France. Au contraire, l’obligation morale de faire les choses correctement dans notre pays s’en est trouvée renforcée.
Sur les échanges entre la mère et le fœtus
Nous devinons tous qu’ils existent, sans être réellement capables d’en déterminer ni l’ampleur ni la teneur exacte. Il ne s’agit nullement de minimiser leur importance dans les deux sens. Une femme peut s’attacher à l’enfant qu’elle porte en elle, comme une nourrice agréée peut s’attacher à l’enfant qui lui est confié tous les jours. Mais chacune sait que ce n’est pas son enfant et que sa relation avec lui est transitoire et supplémentaire à celle qu’il développe avec ses parents. Vers le fœtus, nombre d’échanges complexes existent également, bien que personne n’ait été capable de les démontrer. De même d’ailleurs pour le nouveau-né qui continue de tisser des liens plus ou moins importants avec d’autres adultes que ses parents après sa naissance. La parentalité ne consiste pas à chercher l’exclusivité des liens avec l’enfant. Et quand bien même cette utopie serait fantasmée par des parents, elle serait totalement inatteignable, et c’est bien ainsi. Les personnes qui interfèrent dans l’histoire d’un enfant sont nombreuses. « C’est tout un village qui éduque un enfant ».
Qui est la vraie mère ?
Est-ce la femme qui porte l’enfant, ou est-ce la femme qui a transmis ses gènes ? Ni l’une ni l’autre, probablement. Car la pratique clinique nous met malheureusement au contact de femmes porteuses de leur propre enfant génétique qui ont si peu d’une « mère » qu’elles en effacent la vie naissante, parfois même sans se rendre compte qu’il s’agit de leur enfant. Cette pathologie connue sous le nom de « déni de grossesse » aide à répondre à la question de savoir qui est la vraie mère. La seule réponse qui vaille est que la vraie mère est celle qui adopte l’enfant. Ce mécanisme d’adoption, qui pour la plupart des femmes se fait in utero, et souvent très tôt, peut ne pas se faire. Il n’y alors pas d’enfant. Il ne suffit donc pas d’être enceinte pour attendre un enfant. Même l’accouchement n’est pas suffisant pour construire une mère et nombre de jeunes mères se trouvent projetées dans une profonde angoisse après l’accouchement, tant les difficultés, pourtant fréquentes, de l’adoption de l’enfant leur paraissent inavouables. La mère n’est pas définie par l’utérus où on a grandi, ni même par les gamètes dont on est issu mais bel et bien par l’adoption dont on a été l’objet, plus ou moins tôt, plus ou moins facilement. On le savait pour la paternité. C’est plus difficile à admettre pour la maternité et l’exemple des mères défaillantes à la rubrique des faits divers le prouve malheureusement bien trop souvent.
Les travaux des psychanalystes étrangers sur le vécu de la gestatrice – sujet sur lequel l’expérience française est quasi inexistante du fait de l’interdiction de la GPA – nous enseignent que ces femmes vivent leur grossesse de façon très différente de celle qui a été la leur lorsqu’elles ont porté leurs propres enfants. Ces femmes expliquent être sensibles à la détresse des couples infertiles et font part de leur volonté de les aider, conscientes qu’elles sont en mesure de le faire alors que la médecine même la plus sophistiquée ne le peut pas. Elles font part du sentiment d’accomplissement, de valorisation d’elle-même, voire de forte gratification que leur procure l’acte de gestation, sentiment bien supérieur à la motivation financière.
Danslamaternitéilyaenfaitaumoinstroisévènementsqui s’intriquent profondément :
- le phénomène de transmission génétique
- la grossesse et l’accouchement
- et l’adoption de l’enfant au terme de la grossesse psychique
Il n’y a aucune raison de « sur valoriser » uniquement la grossesse et l’accouchement alors que c’est bien l’adoption qui est la part la plus indispensable de la constitution familiale. Phénomène réciproque en constante élaboration, le contrat entre l’enfant et les parents se dispense bel et bien de la génétique et même de la fugace passade obstétricale.
L’ enfant s ub it-il un abandon par la mère porteuse ?
En fait il est déjà adopté en prénatal par une autre femme mais aussi par un père qui souvent établi une reconnaissance prénatale de sa paternité. Ces deux personnes sont ses parents d’intention sans qui rien n’aurait existé. La mère porteuse joue le rôle d’une « nounou prénatale ». Serait-ce plus discutable d’être une nounou avant la naissance qu’après ? Et d’ailleurs, le contact et la reconnaissance ultérieure de cette femme par l’enfant sont souhaitables vu l’éminent service qu’elle lui a rendu. L’enfant, à qui les événements de sa vie prénatale seraient expliqués sainement, est parfaitement à même de les comprendre. De même que pour la fratrie déjà existante chez la mère porteuse, tout est explicable et ce récit comporte même, par son aspect exceptionnel, une certaine valeur exemplaire de la solidarité de leur mère envers un autre couple auquel elle donne la possibilité de constituer une famille. Il n’y a donc pas abandon à la naissance puisque l’adoption réelle a précédé la naissance, tant pour le père d’intention, qui lui a le droit de faire reconnaître sa paternité avant la naissance, alors que la mère d’intention, elle, ne le peut pas. L’acte de naissance définitif devrait donc comporter aussi le nom de la mère d’intention à la rubrique maternelle en plus de celui de la femme qui a accouché, dont il n’est pas question de taire l’existence.
En ce qui concerne la situation de l’enfant à venir, les travaux menés par des psychanalystes et des anthropologues exerçant dans des pays qui pratiquent la GPA nous fournissent un enseignement précieux. On sait par ailleurs que les émotions de la fin de la grossesse, qu’il s’agisse d’euphorie ou de dépression, secrètent des molécules qui franchissent le filtre placentaire : le bébé hérite non seulement des gènes de la mère génétique, mais aussi d’une partie de l’histoire de la mère gestatrice. Il n’est donc pas question de nier le rôle de chacune, particulièrement de la gestatrice, au regard de l’équilibre de l’enfant, mais d’éviter toute mythification des rapports entretenus par la gestatrice et l’enfant qu’elle a porté durant neuf mois. Pendant ces neuf mois, elle a eu avec lui des échanges variés, physiologiques et psychologiques. Mais sans ignorer ou minimiser ces réalités, nous savons aujourd’hui, tant d’après les données de la psychopathologie périnatale que d’après celles de l’adoption, qu’un enfant porté par une femme qui n’est pas la mère d’intention sera capable, par déplacement, de faire un transfert sur d’autres adultes, à condition que ceux-ci s’y prêtent de façon adéquate. Or c’est exactement ce qui se passe dans une GPA gestationnelle bien accompagnée qui est, en somme, un protocole médical de maternité partagée.
La GPA répondrait à une vision biologisante de la filiation
Il est vrai qu’elle permet à un couple d’avoir un enfant dont la totalité ou la moitié du patrimoine génétique sera fourni par le couple d’intention. Mais cette demande est-elle honteuse ? Ne prévaut-elle pas dans la quasi-totalité des demandes de couples stériles, y compris dans les demandes de greffes d’utérus ? On ne peut ignorer la volonté d’un couple de transmettre, en partie ou pour totalité, son histoire familiale, ce qui se traduit de manière habituelle par l’idée d’hérédité. Il n’y a pas de hiérarchie des modes d’accès à la parenté, mais ceux qui permettent une transmission génétique sont préférés quasiment toujours aux autres, voire au recours à l’adoption. Lorsqu’un couple est empêché pour des raisons médicales de procréer naturellement, il lui revient de choisir parmi les solutions que la loi permet celle qui lui paraît préférable au regard de son histoire. Et ce choix se porte presque toujours vers celui qui ménage le mieux cette transmission d’hérédité.
Les femmes concernées qui se sont exprimées sur le sujet ne s’y trompent pas. Elles connaissent les limites de la génétique et l’importance de l’apport socioculturel. Pour elles, dans la majorité des cas, la GPA leur permet, au-delà de la transmission du patrimoine génétique, une participation corporelle qui induit, même si elle est aléatoire, la question de la ressemblance physique qui d’ailleurs envahit la procréation en général. Les demandeurs souhaitent pouvoir se reconnaître dans leurs enfants et que leurs enfants se reconnaissent dans les traits physiques de leurs parents. N’est-ce pas d’ailleurs pour répondre à ce désir que les médecins pratiquent la technique de l’appariement en matière de dons de gamètes ou d’embryons ?
Rappelons que le droit de la filiation a toujours tenté d’instaurer un équilibre satisfaisant entre le biologique et le socio-affectif et que l’origine génétique continue de jouer un rôle primordial en matière de filiation paternelle. Cette dernière se prouve et se conteste par tous moyens, aujourd’hui essentiellement par l’expertise génétique ordonnée par le juge. La Cour de cassation a rappelé que « l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder».
L’ intérêt de l’enfant est il o ublié ?
Est-ce qu’il vaut mieux ne pas être né plutôt que de l’être grâce à la mise en œuvre d’une GPA ? Peut-on nuire à un enfant en lui donnant le jour ? La situation juridique actuelle de la France est-elle acceptable ? Elle confine en fait à l’injustice car ce sont les enfants qui payent les « errements » de leurs parents en se voyant refuser leur filiation maternelle quand bien même celle-ci serait établie au plan génétique ? L’argument de l’intérêt de l’enfant est bien sûr invoqué mais de fort mauvaise foi car qui peut dire quelque chose de censé sur l’avenir d’un enfant : certains qui ont tout pour être heureux ne le deviennent pas, là où d’autres qui naissent dans des contextes effroyables s’en sortent plus que bien. Et si la préoccupation était véritablement celle de l’intérêt de l’enfant, on n’hésiterait pas à rétablir la filiation maternelle de ces enfants (qui sont là) au lieu de proposer de faire de leur mère une vague tutrice, voire plus récemment de revenir sur la déclaration de paternité effectuée en période prénatale. Certaines décisions de justice dans ce domaine sont parfaitement incompréhensibles au regard de l’intérêt de l’enfant, à tel point que la Cour Européenne des droits de l’homme a condamné par deux fois la France sur ce seul motif.
Pourquoi ne pas avoir recours p lus largement à l’ adop tion internatio nale ?
Elle ne remplacerait pas, même si elle était largement disponible, la demande de GPA car il s’agit d’un autre projet avec d’autres conséquences. Certains futurs parents ne l’envisagent même pas et ce pour de nombreuses raisons.
Les chiffres de l’adoption internationale montrent en fait une baisse constante depuis 10 ans. Le nombre d’enfant adoptés qui était de plus de 6 000 par an il y a 10 ans est passé en 2015 en dessous de 1 000. Seuls les pays qui n’ont pas encore signé la convention de La Haye (maintien de l’enfant dans le pays d’origine) sont encore ouverts à l’adoption internationale. Et on peut s’attendre dans les années à venir à une baisse des adoptions possibles en France, malgré la constante augmentation des demandes. Proposer cette « solution » dans le cadre de l’infertilité utérine définitive, c’est envoyer les parents vers des complications sans fin et souvent vers l’échec au bout du chemin.
Quelle GPA souhaite t-on pour la France ?
Celle qui prévaut aujourd’hui, fait penser à un marché qui n’aurait pas d’autre règle que celle des moyens financiers dont disposent les parents d’intention. Celle qui résulterait d’une clarification adulte et responsable de la GPA serait bien sûr préférable. Ce qui prévaut aujourd’hui, c’est le recrutement sur internet d’une femme plus ou moins distante que l’on paye préalablement dans le cadre d’un contrat qui précise justement qu’après la naissance, on pourra couper les ponts puisque tout le monde sera quitte. Une transaction commerciale et contractuelle donc, déshumanisée le plus souvent et qui s’apparente à une forme d’esclavage moderne.
Mais on peut imaginer que la GPA se déroule autrement, entre des personnes qui se connaissent ou qui se lient dans un rapport de générosité et de solidarité, avec une permanence de la femme qui a porté l’enfant auprès de la famille, et la possibilité pour l’enfant et la femme de se voir ultérieurement comme dans un rapport de filleul à marraine. Cette deuxième option, bien plus humaine, qui passe par le langage et l’explication à l’enfant de ce qui s’est passé, ne met en rien la nouvelle famille en péril. La contribution d’un autre adulte à l’avènement de l’enfant est comparable d’une certaine manière à la contribution d’un donneur de gamète, d’embryon ou de vie pour les enfants nés sous X, à la différence près de l’anonymat. Mais c’est une autre question.
La loi dont s’e s t dotée la France n’autoris e que la greffe d’utérus
Ce qui interdit la discussion et l’analyse au « cas par cas » de dossiers au demeurant très différents. S’autoriser parfois à dire oui à une GPA dans telle ou telle circonstance après s’être assuré que la femme n’est pas Agar et que l’enfant ne va pas subir un mauvais sort, c’est assurément prendre des risques, mais ce n’est pas plus risqué que de continuer à tout interdire au détriment des enfants à naître après des montages parfois sordides à l’étranger. Continuer de tout interdire sauf la greffe d’utérus, c’est conforter la situation actuelle d’un recours systématique au marché procréatif international, dans des conditions peut-être acceptables pour les plus riches, mais dangereuses, honteuses voire sordides quand on ne peut s’offrir que l’Ukraine ou l’Inde. Or l’indisponibilité du corps humain vaut aussi pour les femmes qui n’ont pas la chance d’être françaises et qui seront sollicitées par des couples français auxquels la loi n’aura pas laissé d’autre choix.
Les situations, tant de la gestatrice que de l’enfant, apparaissent à faible risque médical et psychique, à condition que l’ensemble du protocole se déroule dans les conditions qui minimiseront ce risque. C’est pourquoi la GPA, si elle est autorisée, doit l’être dans un cadre strictement défini et contrôlé. Il en ira de même pour la prévention des risques de la greffe d’utérus.
Entre greffe d’utérus et GPA
Les techniques bousculent fortement les structures de la famille et de la parenté d’où l’aspect passionnel des débats qui entourent ces sujets. Protéger un monde qui semble s’évanouir sous nos pieds, coute que coute, n’est pas critiquable en soi. Mais est-ce possible ? Notre époque est privilégiée car elle nous permet d’observer à l’échelle d’une seule génération dans les mœurs de l’homme occidental des changements rapides et risqués. L’humanité est embarquée à vive allure et le vertige est bien sûr au rendez-vous. Défendre avec ténacité tout ce qu’il y a d’humain dans l’homme pourrait constituer une sorte de guide pour l’écriture d’une morale laïque. Il est raisonnable de placer le curseur plus au centre, entre un interdit généralisé et un laisser faire indécent. Et il y a des valeurs qui font consensus dans notre société (non exploitation des humains les uns par les autres, gratuité et égalité d’accès aux soins, droits de l’enfant à naître dans un milieu familial adapté comportant un père et une mère en âge de se reproduire, origine claire des gamètes).
Il est possible que les valeurs essentielles auxquelles nous tenons tous collectivement puissent être bel et bien respectées dans la GPA et dans la greffe d’utérus à condition de les encadrer correctement. Personne ne sait a priori ce qui est bon pour les français qui sont assez intelligents et matures pour qu’on leur donne le droit de décider eux-mêmes de ce qui leur convient le mieux. Entre la greffe d’utérus et la GPA, le choix devrait échoir aux couples eux-mêmes.
-Certains, ne faisant pas le deuil de porter un enfant et de le mettre au monde, opteraient plutôt vers la greffe d’utérus, dont on peut espérer qu’elle soit un jour possible à partir de femmes décédées.
- D’autres, inquiets de la lourdeur d’un tel geste et de ses risques choisiraient plutôt une GPA encadrée et digne, dont les règles auraient été définies par la France et non par des pays qui en font commerce au détriment de leurs femmes.
En ce qui concerne l’indisponibilité du corps humain, seules les conventions qui confèrent au corps humain une valeur patrimoniale sont interdites aux articles 16-1, alinéa 3, 16-5 et 16-6 du Code civil. Mais il n’y a pas de grande différence de ce point de vue entre les deux techniques. On peut donc s’étonner de la promptitude de notre pays à accepter sans réserve l’une tout en continuant d’interdire très strictement l’autre.
En 1991 la Cour de cassation a condamné la pratique de la GPA en tant qu’elle s’inscrivait dans un processus qui visait, d’une part à monnayer auprès de la mère porteuse ses capacités gestationnelles, d’autre part à permettre à des particuliers de contrevenir au principe d’indisponibilité de l’état des personnes. On comprend alors que la formulation de l’article 16-7 du Code civil, par lequel le législateur consacre la jurisprudence, ne vise pas directement le principe de la procréation ou de la gestation pour autrui, mais les conventions qui s’y rapportent, en énonçant que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ».
Ce sujet, non médical mais sociétal, montre bien à quel point le débat démocratique, si difficile sur ce thème, devra bel et bien avoir lieu, sans quoi le décalage grandissant entre l’opinion publique et la loi augmentera encore l’incompréhension des citoyens face à leur loi, qui nourrit de plus un sentiment d’injustice et de stigmatisation pour ceux et celles qui sont confrontés, souvent dans une grande solitude, à la stérilité utérine définitive.
Annexe : Estimation des difficultés respectives (de 0 à 2) des 2 méthodes permettant de constituer une famille malgré une stérilité utérine définitive dans l’état actuel des possibilités techniques
|